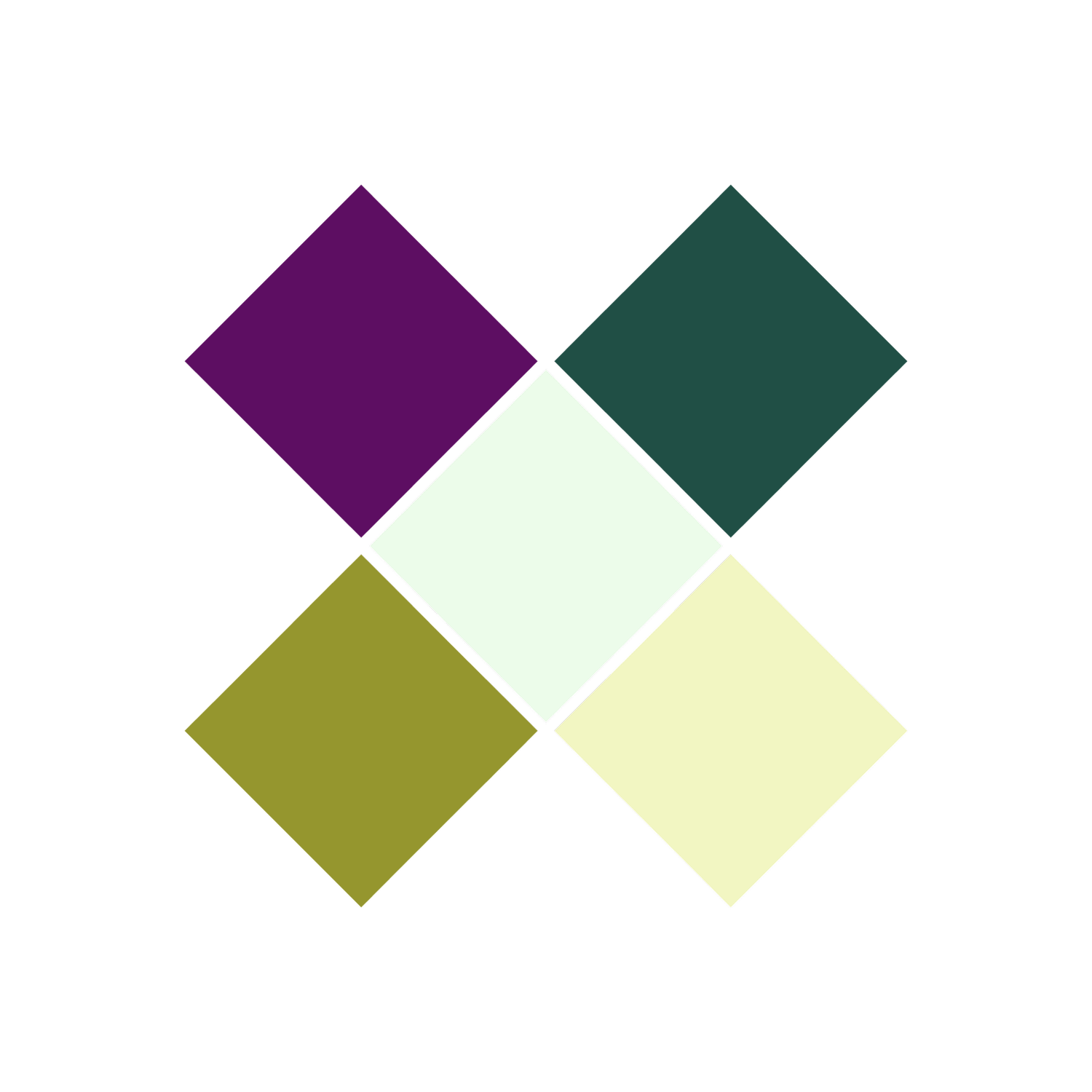Enigme d’un instant figé
Une réflexion poétique sur l’esthétique minimaliste de Jil Sander
Cette scène concentre toutes les caractéristiques d’un mystère malaisant.
Le centre est vide, ce qui n’est pas classique. Cet espace a été laissé libre afin que notre attention se porte sur ce qui se passe autour : l’histoire se déroule à l’extérieur ou hors champ. Une maison est ouverte sur la rue, mais on n’y distingue rien. Elle ressemble à un bloc de construction inachevé. Pourtant, un sentiment étonnant de sérénité et de rassurance nous envahit, comme si nous étions convaincus que cette position d’attente et d’observation aboutira à un dénouement inéluctable.
Nous sommes ainsi embarqués dans trois récits, ou devrions-nous parler de trois actes ?
L’attente
Ici, on attend que quelque chose se produise. Plusieurs éléments nous le suggèrent.
Le plus évident est l’unique élément iconique de l’histoire : cet homme placé à gauche, debout et immobile, dont la posture rappelle celle du poteau situé derrière lui, droit et rigide. Il semble ancré dans cette atmosphère statique, au même titre que cette maison en pierre brune. Il attend manifestement quelque chose à gauche, hors du cadre de l’image. Bien qu’il ne soit pas au centre de la scène, ses ombres, projetées par deux sources de lumière, y prennent place. Même dans l’abstraction, nous percevons et vivons l’attente.
Au centre de l’image, l’idée d’un cadran d’horloge se dessine. Alors qu’au premier regard, toutes les formes paraissent rigides et marquées par des à-coups verticaux, le sentiment de sérénité et de calme, inhérent à l’attente, émerge peut-être de cette forme lisse, ronde et rassurante, tracée dans le goudron.
Le temps passe.
Quelle heure est-il ? L’horloge indique minuit moins le quart, une heure et quart, ou peut-être trois heures vingt. Que se passera-t-il à cette heure précise ?
Le temps s’écoule, souligné par le format horizontal de l’image, symbole d’une ligne temporelle.
La gradation de couleurs perceptible dans le ciel, ce camaïeu de bleus se fondant dans un horizon aux tonalités orangées, fait le lien entre la lumière du soleil et celle du lampadaire, telle une histoire sans fin.
Signe-t-elle la tombée de la nuit ou le lever du jour ? L’aube ou le crépuscule ? L’attente nous le dira.
Le théâtre
Nous touchons ici au second récit de l’image.
Notre position est ambiguë. Sommes-nous de simples observateurs ou bien les spectateurs d’une pièce de théâtre ?
Comme assis parmi un public, nous assistons à une scène dans laquelle nous aimerions entrer. Nous attendons que la pièce commence, que l’histoire se déroule et que les mystères se résolvent.
Tout nous y pousse, notamment cette obscurité qui semble passagère. Le cadran d’horloge s’apparente finalement à une scène, une scène en arc de cercle rappelant les premières formes de théâtre, où l’on se rassemblait autour du feu pour raconter des histoires.
Nous observons un triptyque entre le personnage, le lampadaire et la maison, comme trois protagonistes d’une pièce de théâtre formant un tout. Le vide fait le lien entre ces éléments.
Le décor nous livre des indices sur l’intrigue et laisse place à notre imagination.
Nos sens sont sollicités : la vue par l’obscurité, le toucher par les matières froides et rugueuses du béton et de la pierre. La posture du personnage à gauche suggère un temps froid et sec, mais l’attente reste supportable car il (ou nous) est bien couvert. L’ouïe aussi est stimulée : nous percevons un silence écrasant, brisé par le tic-tac du temps, par le bourdonnement du lampadaire ou les crépitements de la scène qui se joue hors cadre.
Nous vivons à la fois le théâtre joué et écrit. Le sous-titre nous guide, tel une didascalie, en nous apprenant que nous sommes à une station-service en Toscane et que notre personnage s’appelle Malick.
Contrastes et oxymores
Nous sommes dans l’attente d’une scène théâtrale et, en même temps, nous vivons cette attente comme une scène théâtrale. Cette image fixe nous semble animée et superpose subtilement contrastes et oxymores. C’est le dernier récit.
L’image fixe est pourtant vivante, l’obscurité devient accueillante, les bleus et les oranges cohabitent malgré leur opposition chromatique, le vide rassure, la rectitude s’adoucit, le jour flirte avec la nuit, l’hiver est chaleureux, l’attente est confortable, voire salvatrice.
Happés par ce centre vide, notre regard s’élève vers l’axe spirituel : nous tombons sur Jil Sander, seul élément blanc, pur et éclatant, qui semble nous offrir une réponse tombée du ciel.
Révélations sur l’esprit de la marque Jil Sander
Les contrastes révèlent l’essence de la marque Jil Sander, souvent perçue comme brute et austère, mais dont les coupes impeccables procurent confort et réconfort. L’image, comme la marque, nous invite à dépasser l’apparence froide pour en découvrir la bienveillance et le partage, à l’image d’une éthique protestante allemande : disciplinée, patiente et respectueuse.